Le bureau de l’Association, présidée par Isabelle BINARD, ainsi que ses adhérents et invités, m’ont chaleureusement reçue dans leur espace de délibération, créé pour échanger également avec le monde professionnel sur des sujets d’actualité, afin de partager notre expérience clinique et théorique.
Télécharger ici la plaquette de l’Atelier des Psychologues 2013_2014
Je vais retranscrire ici quelques fils issus du débat sur l’imposture managériale et ses effets désubjectivants sur le sujet à son poste de travail.
Nous savons tous que les modèles managériaux servent à rationaliser le travail pour augmenter son efficacité ou son « efficience ». Les pratiques de management qu’elles nous viennent du Japon ou d’Amérique induisent un rapport de domination entre le salarié et son employeur.
Ce qui a changé depuis les années 1990, c’est l’influence de la mondialisation et de la financiarisation sur les activités économiques menées magistralement par les nouvelles méthodes de management. Ce bouleversement participe au désastre des conduites des hommes, asservis, aliénés, dépossédés par des outils de gestion dits performants, bien évidemment, mais pour qui ? C’est toute l’organisation du travail qui est ainsi contaminée et pourtant, serait-elle défendue par une idéologie aberrante qui nous fascinerait ?
Rappelez-vous : France Télécom avec ses réorganisations permanentes, ses mobilités forcées, ses mises en concurrence des agents entre eux, a constaté toute une série de suicides qui sévirent sur ses lieux de travail, du jamais vu !!!
 Un document interne de France Télécom datant de 2006 et relayé mardi 7 mai par Le Parisien témoigne de la violence sociale à l’époque au sein de l’entreprise, actuellement visée par une enquête judiciaire concernant une vague de suicides en 2008 et 2009.
Un document interne de France Télécom datant de 2006 et relayé mardi 7 mai par Le Parisien témoigne de la violence sociale à l’époque au sein de l’entreprise, actuellement visée par une enquête judiciaire concernant une vague de suicides en 2008 et 2009.Le quotidien rend public un fac-similé d’un compte-rendu d’une réunion d’octobre 2006 de l’Acsed, l’association des cadres de France Télécom, deux ans avant le premier des 35 suicides aujourd’hui examinés par la justice.
DES DÉPARTS « PAR LA FENÊTRE OU PAR LA PORTE »
Selon ce document, l’ancien PDG Didier Lombard aurait déclaré : « Il faut qu’on sorte de la position mère poule. […] Ce sera un peu plus dirigiste que par le passé. C’est notre seule chance de faire les 22 000 » suppressions de postes programmées dans le cadre du plan Next, qui visait à réduire les effectifs entre 2006 et 2008.
[Lire la suite]
Au nom d’une « scientificité » inébranlable, la quête de la qualité totale (le Zéro défaut) appliquée par les méthodes du Lean Management, (la chasse aux gaspillages), relayée par l’évaluation individuelle des performances au reporting systématiques, sont des pratiques asservissantes qui nous donnent un aperçu de la « quantophrénie » ou maladie de la mesure qui s’impose comme une autre forme de domination symbolique.
 -Management-
-Management-Le lean management, un danger pour les salariés ?
Par Sabine Germain, journaliste | 05/04/2013
Il se présente comme un « repenti du lean management » : pendant douze ans, Bertrand Jacquier a accompagné le déploiement de projets « lean » dans l’industrie. Le jeune ingénieur avait alors l’impression que « c’était une réponse pertinente aux limites du modèle taylorien. » Il est aujourd’hui convaincu que « c’est un facteur de risque pour la santé des salariés ».
Une conviction qui l’a conduit à reprendre des études de psychologie du travail pour devenir expert auprès des CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) au sein du cabinet Secafi. Ce nouveau poste d’observation lui permet de prendre la mesure des dégâts causés par le lean management : « L’intensification du travail, la diminution de la latitude décisionnelle, la perte de solidarité génèrent à la fois des troubles psychosociaux (RPS) et des troubles musculo-squelettiques (TMS). »
Lire La suite
Les techniques du « lean management, » mode d’amélioration continue de l’organisation du travail, sont loin de faire l’unanimité. Efficace pour réduire les coûts, il serait, contrairement à sa promesse initiale, un danger pour les salariés.
L’Hégémonie du Marché
A la fin du XXè siècle, l’économie financière se substitue à l’économie industrielle. Dans le capitalisme à l’ancienne, il fallait investir le surplus (les bénéfices) pendant deux à trois décennies sur le marché mondial pour développer le capital industriel. Une pulsion de réalisation, pas indifférente au profit, favorisait l’expansion donc la réalisation d’un empire entrepreneurial qui façonnera des modes de vie. C’était cela les forces motrices : créer des produits de consommation issus des recherches et applications technologiques.
Le capitalisme financier révolutionne cette logique pour imposer la sienne. Son horizon, son alpha et oméga : c’est le profit. Peu importe l’objet investi, l’essentiel c’est l’obsession du rendement, soit ce qui va payer plus au risque de quitter le secteur moins rentable sans l’ombre d’un état d’âme. Par exemple, si le yaourt est plus rentable que le nucléaire, les actionnaires réinvestiront dans ce secteur. Voir mon article sur Virgin, sa liquidation et son rachat par le groupe d’actionnaires : Butler Capital Partners.
 Qui est le père du capitalisme financier ?
Qui est le père du capitalisme financier ?
Henry Kravis crée en 1976, avec ses deux associés R. Roberts et Kohlberg une firme d’investissement qui deviendra l’une des plus célèbres des États-Unis « Kohlberg Kravis Roberts et cie, alias KKR. Avec leurs fonds d’investissements, ces actionnaires achètent des entreprises en difficultés pour les optimiser afin de les rendre plus chères dans un temps record. Bénéficiant de la déréglementation en 1980, ils ont appliqué leur méthode à l’échelle de la planète pour en tirer quelques bénéfices phénoménaux. Kravis a inventé le LBO, un outil financier qui permet d’acheter des entreprises, en misant peu, (apport personnel de 20%), avec énormément d’endettement auprès de nombreuses banques, pour que ça produise un effet levier. Cette dette sera rapidement remboursée en prélevant sur « la bête » qu’est devenue l’entreprise rachetée, du cash pour payer les banquiers 3 à 5 ans après. Nous sommes à deux crans de l’otage pris en otage… Ainsi, le groupe KKR dont le père est Henry Kravis, a réussi à prendre possession de nombreux groupes, ils sont partout : médias, communication, laboratoires, jouets, électroniques, universités, hôtels, etc. L’empire de ses ventes dépasse celui de coca-cola et microsoft. Je reprends ces informations du brillant documentaire de Jean-Robert Viallet : la mise à mort du travail, un reportage sur la dépossession raconte l’extraordinaire pouvoir des actionnaires sur le travail et les travailleurs. En effet, l’entreprise familiale Fenwick, rachetée depuis deux ans par le groupe KKR, qui a perdu 100 salariés, voit les accidents du travail augmenter de 20% pour suivre au plus près de la machine, en robotisant ses gestes donc son corps , les consignes du lean management via la qualité totale.
“La Mise à mort du travail”, prix Albert Londres
Ce matin, Jean-Robert Viallet était un homme heureux. Et franchement, nous l’étions pour lui. Ce nom ne vous est peut-être pas encore très familier, mais retenez-le. Dans le petit monde des documentaristes, c’est un vrai bon. Il a été récompensé aujourd’hui par le prix Albert Londres 2010 de l’audiovisuel pour sa mini-série documentaire, La Mise à mort du travail. Un prix amplement mérité. Dès le départ, nous avions défendu cette oeuvre qui parvient comme rarement à rendre intelligible le monde de l’entreprise et à démontrer comment les logiques de rentabilité pulvérisent les liens sociaux et humains au point de tuer le travail lui-même en le ramenant à sa seule composante économique. Un brillant décryptage, fruit de trois années d’un travail long et difficile, car le monde de l’entreprise ne se laisse pas facilement filmer. » Lire l’article d’Olivier Milot sur le site de Télérama.
Quand le travail vivant n’est plus pris en considération, le sujet se désubjective et pour cause !
L’intelligence du travail vivant, soit ce qu’il faut mettre d’énergie, d’astuce, pour faire « coller » le travail prescrit avec le travail effectif, n’est pas mesurable puisqu’il a à voir avec la subjectivité du travailleur. C’est tout l’engagement de sa personne qui est convoqué, psychisme et corporel confondus.Comme il n’est plus reconnu depuis que l’organisation du travail défend stricto sensu le résultat des objectifs à atteindre, en ignorant le réel, soit le chemin parcouru pour y arriver, bien des pathologies explosent. Le résultat est patent, les troubles musculo-squelettiques, le stress, les pathologies de harcèlement, le burn out, le karôshi viennent grever le budget de la sécurité sociale.Pour tenir, ne pas sombrer dans la dépression ou décompenser, il est possible de renforcer ses défenses telles que le déni, la banalisation, le clivage, l’indifférence. Cela a aussi un coût psychique.Plus les méthodes d’organisations sont dures et ne tolèrent pas le consentement, plus les salariés quelque soit leur niveau de responsabilité vont opter pour des positions individualistes. Sachant que comme tout est construit pour les mettre en concurrence, les diviser, les contrôler, la servitude volontaire peut par conséquent fonctionner.Incité à se trahir soi-même en collaborant à ce que moralement on réprouve, l’éthique personnelle en prend un coup, la peur et la honte sont aux commandes.Le lien entre souffrance et travail s’établit, c’est pourtant le travail qu’il faudrait soigner et pas chercher à tout prix à adapter l’homme à un travail ravageur.
« Les nouvelles formes d’organisation du travail dont se nourrissent les systèmes de gouvernement néolibéral ont des effets dévastateurs sur notre société tout entière. Elles menacent effectivement notre cité et nous ont déjà fait faire un pas significatif vers la décadence, c’est à dire vers le découplage tragique entre le travail ordinaire et la culture (si, par culture, on entend les diverses modalités par le truchement desquelles les être humains s’efforcent d’honorer la vie). Il n’empêche ! Même si, sous la loupe de la clinique, ladite décadence est d’ores et déjà commencée, la réorientation dans une direction s’accordant mieux avec la vie est possible. Mais il faut d’abord la penser dans ses principes, puis l’expérimenter. Il faut ensuite la vouloir, et cela ne va pas sans l’appui des institutions et du droit, c’est-à-dire sans que l’organisation du travail soit reconnue et traitée, enfin, comme un problème politique à part entière, qui n’est réductible à aucun autre ».
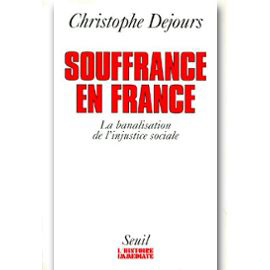 Vous trouverez cette conclusion dans le livre de Christophe Dejours, Souffrance en France réédité en 2009, augmenté d’une préface et d’une postface.
Vous trouverez cette conclusion dans le livre de Christophe Dejours, Souffrance en France réédité en 2009, augmenté d’une préface et d’une postface.
Isabelle Bourboulon est journaliste indépendante, spécialisée en économie de l’entreprise. Voici ce qui nous est écrit dans sa 4ème de couv : « dans son ouvrage fondé sur une grande enquête menée dans différentes entreprises comme IBM ou Mckinsey, mais aussi dans plusieurs services publics, elle y révèle une véritable crise du travail. Croisant des témoignages inédits avec l’histoire du management et le travail de chercheurs les plus reconnus, l’auteure va plus loin que cette dénonciation, elle étudie les exemples d’alter-management et les nouveaux concepts qui permettrait d’instaurer des méthodes de travail plus respectueuses des rythmes humains ».
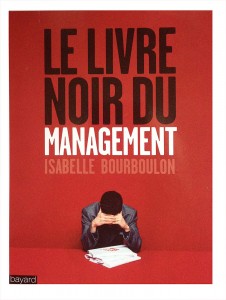 J’ai extrait de son ouvrage quelques observations qui m’ont permis une approche mieux outillée encore pour réussir à bien penser notre rapport à l’autre dans le milieu professionnel d’aujourd’hui, afin de ne pas banaliser ce qui nous rend ou pas citoyen dans une cité démocratique.
J’ai extrait de son ouvrage quelques observations qui m’ont permis une approche mieux outillée encore pour réussir à bien penser notre rapport à l’autre dans le milieu professionnel d’aujourd’hui, afin de ne pas banaliser ce qui nous rend ou pas citoyen dans une cité démocratique.
J’espère avoir contribué par cette restitution à votre intérêt pour ces questions qui ne sont pas liées à la fatalité du destin.
Chantal Cazzadori
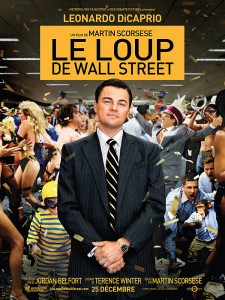 Clin d’Oeil sur l’actualité cinématographique
Clin d’Oeil sur l’actualité cinématographiqueLe nouveau film de Martin Scorcese « Le loup de Wall Street » est calqué sur les mémoires d’un authentique trader, Jordan Belfort, aux origines modestes, qui va devenir un délinquant en col blanc, profitant de la montée en puissance des affairistes de la Bourse. Pour Scorcese, les spéculateurs et autres frondeurs sont de la pire engeance. La haute finance, complètement corrompue, précipite le monde dans une pantalonnade effarante. En prise avec l’air du temps, Scorcese nous dit sa colère de voir la souffrance des gens dans un monde qu’il faudrait remettre d’aplomb. L’impression d’obscénité est rendue sans complaisance pour ce monstre de vulgarité et d’avidité, ce nouveau « Héros » est la caricature « bling-bling », doublé d’un versant grotesque. Nous avons là une magistrale démonstration de la quête de l’impossible, l’appel à la jouissance totale. En effet, ce film est un véritable traité clinique qu’il s’agit de prendre au sérieux. Si le sexe, le fric et la drogue sont des moyens d’addiction du « Loup », nous pourrions regarder de plus près comment cette dépendance fonctionne. Peu importe ce qu’il va vendre, que ce soit un stylo ou des milliards en bourse, ce qui va primer plus que tout, au-delà de l’objet mis en circulation, ce sera son rapport jouissif à déssaisir l’autre (le client) de son propre désir jusqu’au moment de sa capitulation. Obtenir l’adhésion de l’autre, dans une totale manipulation cynique et outrancière, voilà ce qui l’excitera au plus haut point dans la relation « gagnant-perdant », dès que son appât bascule et se « fait avoir » en disant oui à la transaction. Dans cette quête du plus de jouir, l’attrait est sans borne, sans limite. Pourtant, l’opération se retourne, le loup se consume par tous les bouts, « accro » à cette quête, il n’a plus la liberté d’arrêter le processus en marche, il flambe et finit par se détruire lui-même. On constate bien jusqu’à quel point, l’emprise du pulsionnel s’empare de plus en plus du psychisme de la personnalité du trader. Sa vie se déchaîne, rien ne viendra arrêter cette hémorragie obscène, ni même les crises. Le réel n’est plus symbolisable, le piège se referme sur ce loup de Wall Street. N’oublions pas que l’histoire est vraie.
N’est-ce-pas là, une magnifique métaphore de ce qui attend les ultra-libéraux du marché ?


 Follow
Follow