En donnant ce titre : La guérison analytique du dommage dans la vie quotidienne du sujet, je m’étais proposée de parler des solutions que l’analyse peut apporter au problème de l’insatisfaction telle qu’elle se présente dans l’hystérie, névrose particulièrement dédiée et consacrée à cet état affectif. L’hystérie bien malmenée aujourd’hui puisqu’à nouveau, après que la psychanalyse lui a assuré une certaine lumière, elle est cachée dans les traitements et compréhensions généralement répandues sous le voile épais de la souffrance physique des douleurs, dans les marécages des troubles de la sexualité épanouie qui serait un des besoins de notre bonne santé, sous toutes formes imaginables d’écart par rapport aux satisfactions considérées comme normales, et tout particulièrement dans les angoisses et les dépressions.
Un long parcours d’analysante m’a amenée à me reposer la question de la satisfaction (de l’insatisfaction) au cœur de ce noyau de la névrose où se présente comme une idée de ce qui se maintient dans la répétition névrotique et s’oppose à un dénouement satisfaisant. L’insatisfaction dans l’hystérie est-elle inspirée par la réalité rencontrée dans l’analyse, une réalité sexuelle où le rapport attendu n’arrive pas, où la jouissance se présente toujours ailleurs, où il est vain voire dangereux, de chercher à l’attraper ? Les fictions, les romans, les théories que la névrose inspire sur son drame personnel, sur la comédie jouée au prix de sacrifices imposées dans la répétition, sont-ils vrais ? Ou plutôt, ne sont-ils que vraisemblables et que peut-on en faire ? Jusqu’où le symptôme lui-même est-il analysable ? Son analyse complète est elle nécessaire, exigible, possible ? La dialectique insatisfaction-satisfaction, qui relève depuis Lacan du rapport du sujet à la jouissance, est-elle une porte d’entrée pour interroger comment il est possible de se déprendre du magnétisme exercée par sa quintessence, le penisneid, pour prendre le cas chez la femme, l’envie de pénis ? Freud n’hésite pas à coller ce nom à ce qui se joue chez elle dans les fins d’analyse difficiles, mais je trouve plus vraisemblable de l’étendre à toutes.
Dans son texte L’analyse avec fin et l’analyse sans fin (1937), Freud insiste beaucoup sur l’aspect quantitatif dans la métapsychologie de la question de la fin de l’analyse. C’est un regain de la puissance des pulsions qui ne sont plus tenues en respect par les forces refoulantes, qui détermine les rechutes dans la névrose au cours de la vie, signifiant ainsi que l’analyse n’était pas terminée. C’est la même énergie qui anime la revendication opposée à l’analyste, opposée à la guérison dans les cas pris pour exemple d’analyse interminable. Que ce soit les événements de la vie, un nouveau trauma, une incitation provenant du cycle biologique, la force constitutionnelle des pulsions ou les défauts du moi qui soient à l’origine de l’excès de cette exigence pulsionnelle, Freud souligne l’aspect quantitatif dans le rapport de force, pour, dit-il rétablir les droits du point de vue économique. Mais il laisse entendre par là que ces rechutes auraient pu ne pas arriver, que ces fins d’analyse auraient pu ne pas rencontrer ce même obstacle…
Freud n’inscrit aucune modalité programmatique pour la guérison de la névrose. Il dit: « Au lieu d’examiner comment la guérison advient par l’analyse, ce que je tiens pour suffisamment élucidé, la question à poser devrait être : quels obstacles se trouvent sur le chemin de la guérison analytique » . Il est difficile de ne pas lire dans ce texte qui se présente aussi comme un hommage à son ami Ferenczi, que le principal obstacle qui se présente à la guérison, c’est l’hystérie. C’est l’objection que l’hystérie oppose à la guérison en refusant de se satisfaire des résultats, même substantiels, qu’elle a obtenus. Elle refuse de s’en servir pour affronter les épreuves de la vie, elle réclame à l’analyste un résultat plus complet. Elle veut le phallus pour reprendre le nom lacanien du pénis qu’elle envie.
D’un autre côté, nous dit Freud, « en cas de force pulsionnelle excessivement grande, le moi mûri et soutenu par l’analyse échoue dans sa tâche, tout comme autrefois le moi démuni » . Et comme le cas d’une force pulsionnelle excessivement grande renvoie au « facteur quantitatif que n’aimons pas voir », on peut dire, je cite Freud, « que l’analyse, avec sa prétention de guérir des névroses en assurant la domination sur les pulsions, a toujours raison en théorie, mais pas toujours en pratique ».
D’un côté, donc, le moi freudien se cabre et refuse la guérison, de l’autre, il échoue dans une tâche trop difficile.
En tous les cas, sa plainte est d’être laissé dans une situation insatisfaisante.
L’hystérique n’a pas médité la phrase où Christiane Lacôte-Destribat résume la « simplification » où elle s’enferme, dans l’article jouissance du dictionnaire de la psychanalyse de Roland Chemama : « la jouissance humaine est irréductiblement marquée par le manque et non par la plénitude, sans que cela relève de la seule problématique – c’est là la simplification proposée par l’hystérie – de la satisfaction ou de l’insatisfaction ».
Comment cette jouissance humaine non réductible à la satisfaction ou à l’insatisfaction se présente et s’appréhende dans l’analyse ? Si nous admettons que le déplaisir est une tension liée à une trame langagière où le sujet tente de répéter un mouvement vers une satisfaction, sa jouissance est dans la satisfaction vers laquelle il tend et qu’il imagine, tout en éprouvant du déplaisir. Sa jouissance est ce déplaisir bien plus qu’une quelconque satisfaction. En proie à la jouissance du déplaisir, le sujet conçoit le lieu de la jouissance de l’Autre comme une plate-forme céleste où il rencontrerait la satisfaction et où il pourrait parvenir. Pour cela, il lui faut accéder au savoir de l’Autre. Toute l’analyse se déroule dans la poursuite d’un savoir dont l’Autre est le lieu, accompagnée par l’analyste.
Nestor Braunstein nous présente dans un texte intitulé Le savoir dans l’hystérie (« savisme »), dans une description haute en couleurs, les soubresauts et les mésaventures de la quête de cette dernière dans le transfert, lorsque le savoir devient l’enjeu d’un affrontement avec l’analyste identifié comme son détenteur et son possesseur. En sollicitant son analyste comme Maître ou comme Professeur, en déroulant toutes les impasses de ces positions identifiées, un transfert passionnel nous est dépeint où le discours de l’analyste peine à reprendre la main. L’insatisfaction, la revendication, la bataille, l’agression, sont au rendez-vous dans ce texte-récit où un transfert négatif exacerbé se conjoint à un amour de transfert passionnel en produisant un effet quasi-comique. Aussi vivant et percutant soit ce texte, il me semble appeler le commentaire que dans un transfert, tout n’appartient pas à la passion intraitable de l’hystérique, l’analyste a sa part dans l’incendie. Mais il présente l’avantage de dérouler sans fléchir la course folle où s’embarque le couple analysant-analyste. Tout le développement est orienté par la question du désir de l’analyste. Il souligne et illustre ainsi la nécessité structurale de l’absence de solution dans l’analyse à l’insatisfaction que le désir s’évertue à réclamer de boucher et de maintenir à la fois.
Dans sa partie conclusive, Nestor Braunstein nous propose de penser que « [le] problème, pour résumer, est celui de passer du savoir comme objet du fantasme au savoir de la structure comme vérité du discours de l’analyste ». On pourrait aussi dire : de l’analysant. Ce savoir comme objet du fantasme était l’enjeu dans la relation transférentielle passionnelle. Mais que peut être le savoir de la structure, au delà du savoir de l’analyste ? Il n’y a pas de savoir de la structure détachable de l’effet de vérité de sa reconnaissance. Sinon, nous retomberions dans un savoir positif sur l’inconscient. Nous pourrions savoir qui est l’hystérique. Le même N. Braunstein soulignait l’année dernière au Congrès d’Analyse Freudienne que Lacan n’a jamais parlé de névrose, psychose et perversion comme de structures cliniques étanches qui feraient apparaître le névrosé, le psychotique et le pervers comme des sujets-objets.
La structure est selon moi l’expérience de « comment ça marche » dans l’analyse. Dans le progrès de celle-ci, la jouissance promise n’est pas au rendez-vous et à la place, c’est de la jouissance non invitée, pénible, ingérable qui se présente. Les projets chéris échouent et la question de comment se répète cet échec prend, à force de se poser, une nouvelle dimension. Il y a la question de ce qu’il signifie, mais surtout l’expérience de la différence que la répétition fait rencontrer, car tout en se répétant, ce n’est jamais la même chose. Elle conduit aux limites et à la précarité du sens, aux condensations imaginaires, à la redécouverte toujours autrement du désir du sujet comme désir de l’Autre. La structure transparait car à maintes reprises le projet qui a construit le transfert et l’objet du fantasme dans celui-ci n’a pas abouti, mais il a pu en être dit quelque chose. A cet endroit survient le moment décisif de la fin de l’analyse où jamais peut-être ne manquent quelques unes des images transgressives et violentes dont est truffée le texte de Braunstein sur le « savisme » de l’hystérique. Freud l’évoque en qualifiant sans ambages ce moment pour la femme par le penisineid. J’ai l’impression qu’il n’est pas possible d’en sortir avec l’assurance d’avoir fait le travail que l’on devait faire. Le défaut du phallus espéré implique la chute de l’objet que je voulais être dans le désir et pour la jouissance de l’Autre. La conséquence ne peut être silencieuse. Personne ne peut accepter sans regimber une perte aussi précieuse : sa propre valeur narcissique et sexuelle. Dans le paysage amoureux du transfert où il a appris à se reconnaître et à soigner son malheur névrotique, le sujet se trouve à présent trompé et dévasté. A présent peuvent survenir, évoqués par Freud en terminant L’analyse avec fin et l’analyse sans fin, des « accès de dépression grave née de la certitude intérieure que la cure ne servira de rien et qu’aucune aide ne peut être apportée à la malade ». Ce moment de la partie analytique se projette heureusement sur un autre canevas, sur lequel est appelée une autre réponse, celui de la psychanalyse, censée pouvoir dire toujours quelque chose de plus sur l’inconscient et donc censée pouvoir répondre quelque chose à l’analysant, au-delà du naufrage de son amour dans le transfert.
Freud a marqué toute question de structure en psychanalyse par son attachement à la phase phallique envers et contre toutes les objections qui lui ont été faites à ce sujet. Il est resté intransigeant sur la question d’un seul organe génital faisant référence pour les deux sexes, qui peut manquer dès le départ pour les unes ou ensuite pour les autres. Cette exigence freudienne d’une différence élevée à l’universel, opérée par un universel de la différence sexuelle, est restée à mon sens une contribution psychanalytique à ce que « homme » et « femme » forment des signifiants dans la culture, des vecteurs de subjectivité et non des appellations de sous-catégories biologiques que certains voudraient voir en eux. La persistance de l’expérience analytique, sa non disparition encore par pertes et profits dans toutes les psychothérapies, ni son absorption dans les psychologies et dans tout ce qui a voulu expliquer et résoudre la plainte de ne pas pouvoir vivre son sexe, vient originellement de cette position de Freud de n’avoir jamais cédé sur ces obscures et délicates affaires de zizi et de perte, pour la petite fille comme pour le petit garçon, du seul organe qui compte, le phallus.
Nous pouvons lire toutefois sous la plume de Freud dans Pour introduire le narcissisme (1914), que dans certaines névroses, le complexe de castration semble ne jouer aucun rôle… N. Braunstein le souligne dans un article intitulé Œdipe viennois comme occasion périphérique où Freud bat en retraite sur la nécessité structurale de la castration. Braunstein le rappelle pour mieux mettre en évidence cette nécessité dans sa lecture de l’œuvre freudienne, dans laquelle il voit une grande construction à plusieurs entrées où l’Œdipe, entré en scène précocement, ne cesse de sombrer, tandis que la castration s’élève pour devenir le roc même sur lequel bute la psychanalyse dans L’analyse avec fin et l’analyse sans fin.
Braunstein pose que l’Œdipe de Freud est en place de l’inanalysé du fondateur de la psychanalyse. Il n’est pas le premier à le faire, rappelons que Lacan proposait comme exemple parmi d’autres de sinthome « le complexe d’Œdipe pour Freud ». Pour Braunstein, l’homme Freud ne s’est jamais « séparé » de sa mère. Il est lui-même Œdipe coupable du crime, de la transgression ; il a tué son père, épousé sa mère. De là viennent les descriptions freudiennes idéales de l’amour mère-fils, le seul amour à être aussi pur, aussi plein et aussi dénué d’hostilité. Freud déforme même la pièce de Sophocle pour la mettre au service de son projet : c’est en fait et contrairement à ce qu’il nous en dit, au départ de la tragédie, Jocaste, la mère, non Laïos, le père, qui envoie l’enfant pour être exposé et mourir. A la fin, la mort de Jocaste est autant le fait d’Œdipe que d’elle-même, puisque non seulement il ne l’empêche pas de se suicider, mais il court justement vers sa chambre avec un poignard.
Le projet de l’Œdipe freudien serait donc tout autour de cet idéal d’amour mère-fils, dont nous pouvons remarquer qu’il remplit aussi l’imaginaire d’une plénitude et d’un bonheur sans égal. Observons que cela implique pour la femme un destin tout orienté dans l’équation pénis-enfant. La plénitude-satisfaction dans son enfant mâle renvoie la femme à l’insatisfaction partout ailleurs. L’échec si fréquent dans la construction de la sexualité féminine sur lequel Freud insiste tout au long de son article Sur la sexualité féminine, l’impression que dégage ce texte que la civilisation finalement ne réserve pas grand chose pour la femme, peut se lire à mon sens comme un constat d’échec de cet idéal, en 1931. Nous voyons ainsi sombrer l’Œdipe freudien avec l’idéal qui le soutenait.
Lorsque N. Braunstein déchiffre une montée de la castration, une courbe ascendante au regard de l’importance décroissante accordée au complexe d’Œdipe dans l’œuvre freudienne, il souligne le progrès du dégagement signifiant du phallus, de la logique symbolique de ses transpositions, des échanges qui régulent ces possibilités au cours de la vie et nous arrivons finalement à une psychanalyse ordonnée par la castration.
Cet ordre de la castration est à mon sens indispensable mais aussi indépassable en psychanalyse, en théorie comme en pratique. Il l’est d’autant plus quand la guérison de la névrose intervient et quand l’horizon étroit de la satisfaction-insatisfaction dans le principe de réalité s’élargit au champ de la jouissance que Lacan appelait de ses vœux comme le champ lacanien.
Comment sa jouissance, à l’issue d’une psychanalyse ordonnée par la castration dans le fil de l’exigence freudienne, peut s’organiser autrement pour l’analysant que dans les symptômes où elle s’est concentrée jusqu’alors ? Comment peut-elle cesser de l’endommager par son excès, ses chemins de traverse quand le sujet s’en trouve réduit au silence et à l’impossibilité de se déprendre des délices et des supplices qu’elle lui inflige dans un temps qui se dissout ? Le mot de jouissance suggère une promesse et une voie vers un évanouissement désiré. Ce mot pointe aussi vers un savoir sur la jouissance, une science de la jouissance. Qui possède ce savoir ? S’il le possède, il possède aussi la jouissance. L’analyse est un processus de désenvoûtement de la jouissance de l’Autre : une jouissance qui coïncide avec les fictions dans lesquelles croire en elle dans l’Autre. Celles-ci sont elles-mêmes jouissance, épopée, saga, romance, histoires glauques et comiques…
En nous tournant vers un ouvrage du même auteur, Nestor Braunstein, La jouissance, un concept lacanien, nous pourrons peut-être avancer un petit peu sur ce passage dans l’analyse entre l’orbite de l’insatisfaction et le champ de la jouissance. Nous pourrons peut-être au passage nous éclairer sur la jouissance et son rapport à la castration.
L’auteur pose la jouissance comme originairement issue de la détresse et de la douleur face à l’innommable Chose, cette perte originaire à jamais inconnaissable. La jouissance pousse au-devant, carburant inépuisable jaillissant de l’originelle alarme de la vie humaine plongée dans le langage, qui, à jamais interdira la jouissance de la Chose. L’intervention de l’opération métaphorique instaure un manque qui prendra en charge une organisation du réel, de l’imaginaire et du symbolique. La perte peut maintenant devenir manque. Ce manque est le phallus, il implique un procès de déchiffrage qui n’est autre que le procès de déchiffrage de la jouissance à quoi le sujet va passer sa vie. La jouissance phallique est qualifiée de jouissance sémiotique pour marquer son intimité avec le langage et avec le procès du déchiffrage. La jouissance Autre, supplémentaire, que cet auteur aime marquer après Lacan comme jouissance de l’Autre (sexe), est avec la jouissance phallique dans une relation de contingence. Elle l’accompagne éventuellement. Mais la jouissance Autre n’est pas toute seule quelque chose qui peut se compter en elle-même sans la dimension de la jouissance phallique.
Ces jouissances définissent le sujet dans son rapport à la sexuation. Elles sont « sa » jouissance et elles ne sont par définition pas complètes, elles ne sont pas la jouissance mythique promise dans le fantasme. Quand à la jouissance de l’Autre, de celui dont la consistance est assurée par la croyance que le sujet en a, religion, savoir, psychanalyse, psychanalyste, mère, père, etc…, le sujet s’en sert pour déployer les figures dans lesquelles il s’en fait l’objet, à l’instar de ses procédés dans le transfert analytique. Braunstein souligne au début de son ouvrage que si le désir est dialectique – le désir du sujet étant le désir de l’Autre – les jouissances se jouent dans une logique oppositionnelle. La jouissance du sujet n’est pas la jouissance de l’Autre.
Il me semble par conséquent qu’il est impossible de s’assumer sujet de la jouissance de l’Autre, mais il est possible de le faire pour la sienne. C’est même le sens de la responsabilité sur son inconscient. Finalement, la jouissance du sujet est sémiotique et phallique, la jouissance supplémentaire de l’Autre (sexe) peut l’accompagner. Sans le rapport au refoulement qui s’articule à la jouissance phallique, la jouissance reste un horizon mythique et imaginaire ou bien la réalité de l’objet dans la jouissance de l’Autre. Mais c’est surtout le découplage radical d’avec toute concordance à une adaptation dans un principe de réalité qui confère à la jouissance humaine un caractère étrangement et paradoxalement omniprésent. Ce qui tendrait à la conclusion que l’élaboration du refoulement et de ses conséquences reste la tâche indépassable de la psychanalyse dans la névrose et le seul moyen de sa guérison.
« La correction après-coup du processus de refoulement originaire, laquelle met fin à la puissance excessive du facteur quantitatif, serait donc l’opération proprement dite de la thérapie analytique » dit Freud dans L’analyse avec fin et l’analyse sans fin. La puissance excessive du facteur quantitatif nous renvoie au déplaisir et à la jouissance et la correction analytique du refoulement à sa limitation. Nous sommes donc du côté de la jouissance phallique, de l’ordre de la castration.
La psychanalyse semble nous dire : non, tu n’apprivoiseras pas ta jouissance. Au mieux, tu la trouveras limitée par le refoulement d’un côté, supplémentaire et contingente de l’autre. La jouissance a donc réduit ses prétentions imaginaires depuis le paroxysme du penisneid où elle semblait se satisfaire massivement dans l’insatisfaction. Le passage de ce « roc d’origine » n’a rien emprunté à une innovation. Il s’est contenté de poursuivre la tâche assignée de toujours à l’analyse. Son résultat n’est que la forme particulière dans laquelle une analyse peut sortir de la revendication d’une satisfaction impossible en poursuivant le frayage du désir qu’elle a pratiqué depuis longtemps déjà.
Anna Konrad, septembre 17
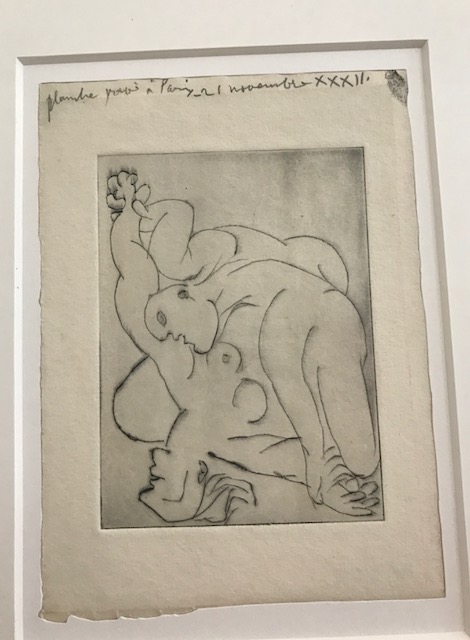

 Follow
Follow